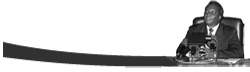JEUNE AFRIQUE N° 1439 — 3 AOUT 1988
POLITIQUE ET ÉCONOMIE
Juvénal Habyarimana Quinze ans après
PROPOS RECUEILLIS PAR MARIE-ROGER BILOA
Le président du Rwanda vient de fêter l’anniversaire de son accession au pouvoir, le 5 juillet 1973. Bilan et perpectives.
Bien que cette interview du président Juvénal Habyarimana soit la première que nous publions, le chef d’État rwandais n’est pas un nouveau venu sur la scène politique : le 15 juillet, il célébrait le 15e anniversaire de sa prise du pouvoir. Ce jour-là, en 1973, il renversait en effet Grégoire Kayibanda, le premier président du Rwanda indépendant, à la suite d’un coup d’État sans effusion de sang.
Jusqu’en 1963, des conflits ethniques avaient fait rage entre les Hutus (90 % de la population) et les Tutsis. Pour gouverner de manière stable, il fallait faire de la réconciliation nationale l’objectif primordial.
Juvénal Habyarimana est apparu comme l’homme de cette réconciliation. Ancien élève du collège Christ-Roi de Nyanza, ville royale, ce natif de Rambura, à l’ouest du pays, sortit major de la première promotion de l’école des officiers de Kigali, la capitale, avant d’être admis successivement dans les écoles royales militaires de Bruxelles et d’Arlon en Belgique. Il est chef d’état-major de l’armée rwandaise dès 1963, donc un an après l’Indépendance (1er juillet 1962). C’est sous son commandement que l’armée aura à combattre les « Inyenzis », c’est-à-dire les Tutsis chassés du pays en 1959 et qui voulaient y retourner par la force. La victoire de l’armée rwandaise sur les insurgés valut au général Habyarimana — dont le nom signifie « Dieu est le créateur de toutes choses », — une grande popularité et un poste au gouvernement. Pendant six ans, il sera ministre de la garde nationale.
Âgé aujourd’hui de 51 ans, celui que les Rwandais avaient fièrement surnommé à ses débuts le « mugabo » (l’homme viril) en raison de sa carrure d’athlète, a incontestablement assis son autorité.
M.R.B.
« Peu rentables, plusieurs entreprises publiques seront privatisées.»
Jeune Afrique : Le 5 juillet, vous avez fêté le quinzième anniversaire de votre accession à la tête de l’État rwandais. Comment expliquez-vous cette stabilité ?
Juvénal Habyarimana : Elle est le résultat d’une politique que nous avons instaurée en 1973, et visant à sensibiliser les Rwandais au fait qu’ils appartiennent à une même nation. Paix et unité : ils ont compris cette priorité. La composition ethnique de notre pays a causé assez de conflits dans le passé. Nous avons par ailleurs assez de problèmes à résoudre : la poussée démographique, la petitesse de notre territoire situé loin de la mer, sans ressources naturelles. Il s’agit rien moins que de survivre ! En 1975, nous avons créé le MRND [NDLR : Mouvement révolutionnaire national pour le développement]. Un mouvement de rassemblement, un cadre de réflexion et de critique où il n’y a pas de sujets tabous, à condition de respecter une certaine discipline. Chaque année, nous réfléchissons ensemble sur des thèmes politiques, principalement sur le développement rural, qui n’est pas un slogan pour nous, mais une réalité : les Rwandais vivent éparpillés sur toutes nos collines. C’est là-bas que nous devons créer des centres de santé, amener l’eau, l’électricité.
J.A. : Dans le domaine économique, vous poursuivez à présent une politique de privatisation. Pourquoi ?
J.H. : L’État ne peut pas tout faire. Nous nous sommes rendu compte que les entreprises appartenant à l’État étaient les moins bien gérées et les moins rentables. Nous avons donc pensé à en privatiser une partie. Pas toutes, bien sûr, car certaines sont par essence même du domaine public (transport, œuvres sociales). L’État veut les céder ou tout au moins y faire largement participer le privé. Pour les entreprises mixtes, telles la STIR (Société de transports internationaux), l’État voudrait ne conserver que les actions lui permettant d’intervenir pour imposer son point de vue dans les choix d’ensemble. Nous avons commencé par des entreprises hôtelières, la société de transport, l’imprimerie nationale et une entreprise qui fabrique des couvertures.
J.A. : Il n’y a pas de femmes au gouvernement. Pourquoi ?
J.H. : Il n’y a pas que le gouvernement qui mette en valeur les capacités d’une personne. Tous les Rwandais ne peuvent pas être ministres ! Néanmoins, des femmes siègent dans d’autres organes, notamment au Comité central. Au Parlement, nous en avons neuf.
J.A. : Sur combien ?
J.H. : Sur 70. Oh, la proportion est peut-être faible, mais allez voir dans d’autres Parlements, même européens…
J.A. : Tout de même, votre parti national, le MRND, vient tout juste de décider que l’organisation des femmes serait intégrée en son sein. Pourquoi une évolution si tardive ?
J.H. : Le mouvement date de 1975 et on ne peut pas tout faire à la fois.
Nous avons commencé par l’organisation intégrée des travailleurs. Après les femmes, nous allons penser à l’organisation de la jeunesse. Cela dit, les femmes jouent surtout un rôle à la base. A la campagne, vous verrez des femmes chefs de cellules dans les communes.
Vous les voyez dans les champs, les coopératives… Ce serait une injure si je mettais une femme au gouvernement uniquement parce que c’est une femme.
J.A. : Justement, pensez-vous que le débat sur l’idéologie est dépassé et qu’il n’y a plus lieu de parler de « modérés » et de « progressistes » ?
J.H. : Je n’ai jamais été acquis à ces principes idéologiques. Peut-être parce que je suis venu à la politique par accident. Ces étiquettes qu’on colle aux gens servent à quoi ? À l’OUA, nous entendons dire : « Celui-là est progressiste, celui-ci modéré, capitaliste, socialiste », alors que nous exposons les mêmes problèmes : la famine, la pénurie d’eau à la campagne, le manque d’écoles, de vêtements. Notre problème, ce n’est pas le socialisme, mais le manioc.
« Nous ne pensons pas que l’Église soit l’ennemie du développement. »
J.A. : Pensez-vous que l’Église puisse constituer un danger pour l’État ?
J.H. : Dans quel sens ?
J.A. : Au Burundi voisin, l’Église a été considérée sous le régime précédent comme ennemie du développement…
J.H. : Chaque pays a sa conception des choses, mais je ne vois pas en quoi l’Église serait un danger. Au Rwanda, elle joue un grand rôle. Nous sommes chrétiens à plus de 70 %. Et nous associons l’Église et ses responsables au débat national.
J.A. : Y a-t-il des prisonniers politiques au Rwanda ?
J.H. : Certainement. Ils ne sont plus très nombreux, je n’en connais pas le nombre exact. Peut-être une dizaine.
J.A. : La peine de mort existe chez vous. Comment la justifiez-vous ?
J.H. : Je n’ai pas fait discuter la question par l’ensemble des citoyens. En tout cas, il y a longtemps qu’elle n’a pas été appliquée.
J.A. : De quand date la dernière exécution ?
J.H. : De 1974.
J.A. : Vous avez donné à l’aéroport international de Kigali-Kanombé le nom de votre prédécesseur, Grégoire Kayibanda, que vous avez vous-même renversé. C’est une mesure assez rare…
J.H. : Le 5 juillet 1973, en fait le 4 juillet, probablement à 11 heures du soir, j’ai pris la décision de suspendre la politique du président Kayibanda. Le lendemain, dans ma déclaration, j’ai dit que le président Kayibanda avait beaucoup travaillé pour le pays. Ce sera d’ailleurs une chance pour moi si je travaille autant que lui… Les reproches qui ont pu lui être faits après coup ne doivent pas effacer tout ce qu’il a fait de bon. Voilà pourquoi l’aéroport porte son nom. De même, nous cherchons à commémorer tous nos héros nationaux. Nous sommes en train d’aménager la tombe de l’ancien roi à Nyanza. Nous n’étions pas d’accord avec toutes ses décisions, mais il faut lui témoigner notre reconnaissance.
J.A. : Le Rwanda, comme les autres pays africains, condamne l’apartheid. Mais que peut faire concrètement un État comme le vôtre pour contribuer à sa suppression ?
J.H. : Pas grand-chose, si ce n’est d’exprimer la conviction morale que ce régime désuet est à abattre. Des organisations affiliées à l’OUA aident les mouvements de libération : le Rwanda cotise régulièrement, malgré ses modestes moyens, il ne figure jamais parmi ceux qui ont des arriérés. Bien entendu, nous n’entretenons pas, non plus, de liens commerciaux avec le régime de l’apartheid.
J.A. : Trente ans après, le panafricanisme reste-t-il un rêve réaliste ?
J.H. : Bien sûr, et c’est cela que vise l’OUA. Nkrumah et les autres ont fait le premier pas. Maintenant, on se rend compte que l’idéalisme ne suffit pas. Au sein de l’OUA, en 1980, la session extraordinaire consacrée à l’économie était une étape importante : tous les ensembles régionaux, s’ils sont renforcés, sont autant de progrès vers une Afrique unie; on ne peut pas aller coopérer avec quelqu’un qui se trouve à 10 000 kilomètres si on ne peut pas entrer chez son voisin pour des questions de papiers.
J.A. : Parlons, si vous voulez bien, des réfugiés rwandais. Vous avez évoqué ce problème à l’ouverture du 6e congrès du MRND, en juin.
J.H. : En 1959, nous avons dit non à la monarchie; et certaines personnes ont fui notre révolution. Plus tard, elles ont demandé à revenir. Nous avons mis en place une réglementation : ceux qui l’ont suivie sont rentrés. D’autres disent : nous voulons tous rentrer, en masse. Mais comment faire ? Il n’y a pas un centimètre carré de libre. Comment voulez-vous accueillir encore 200 000 familles ? C’est impossible ! Voilà ce que nous expliquons aux pays qui les hébergent, en leur demandant de les naturaliser, et aussi de leur donner des terres. La Tanzanie, le Zaïre l’ont fait. Nous en appelons aussi à l’aide de la communauté internationale.
J.A. : Vous avez opté pour une politique d’émigration en direction de certains pays africains. Où en êtes-vous ?
J.H. : Pas très loin. Alors que nous négocions pour que certains Rwandais de l’intérieur émigrent, nous ne pouvons pas demander à ceux qui sont déjà hors des frontières de revenir : ce serait une contradiction. Nous avons donc contacté nos voisins dans le cadre des entités sous-régionales. D’abord le Gabon, mais ça n’a pas marché, puis le Congo et la Tanzanie — nous sommes toujours en pourparlers. Nous nous sommes heurtés à un problème de financement. Parce que, dans les zones d’installation des émigrants, il faudrait des infrastructures : des adductions d’eau, des écoles, des routes, tout cela fourni par le gouvernement rwandais. Il aurait fallu investir 60 milliards de nos francs en Tanzanie pour un million d’émigrés, c’était beaucoup trop. Si nous disposions de cet argent, il ne serait probablement pas nécessaire que ces Rwandais s’en aillent ! La Tanzanie étant bien disposée, nous réfléchissons à une autre solution.
J.A. : Quel est selon vous, en politique, le principe à observer en toutes circonstances ?
J.H. : Faire avancer mon pays. Même les plus petits pas me donnent des satisfactions. Je voudrais par ailleurs changer l’image du chef. On le considère chez nous comme quelqu’un d’inaccessible, on l’entoure de pas mal de règles protocolaires, comme en Europe. Je crois qu’il faudrait que l’on définisse les responsabilités à partir de nos traditions et que le chef ne soit plus considéré comme étant au-dessus des autres, mais un parmi les autres, et un serviteur. Voilà mon idéal. •