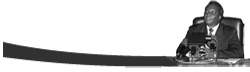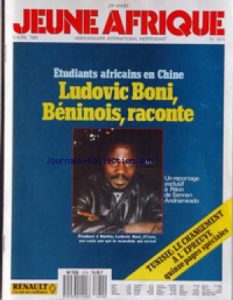JEUNE AFRIQUE No 1474 – 5 AVRIL 1989
INTERVIEW
Juvénal Habyarimana
Les quatre vérités d’un homme tranquille
PROPOS RECUEILLIS PAR MARIE-ROGER BILOA
Les difficultés de l’intégration régionale, la crise belgo-zaïroise, les problèmes ethniques et les réfugiés, la mort de Dian Fossey… Le chef de l’État rwandais répond, sans détours, aux questions de notre envoyée spéciale.
Le Nil prend-il sa source au Burundi ou au Rwanda ? Bien imprudent celui qui s’aventurerait à trancher cette amicale polémique, aux enjeux essentiellement touristiques ! Une certitude, cependant : de tous les pays riverains du fleuve le plus long du monde (6 670 km), le Rwanda est, politiquement, le plus stable. En vingt-sept années d’indépendance, ce petit État de 26 338 km2 n’a en effet connu qu’un seul changement de régime.
Pourtant, comparée à celle de présidents plus récemment installés, comme l’Ougandais Yoweri Museveni (trois ans), le Kényan Arap Moi (dix ans) ou même le Burundais Pierre Buyoya (un an et demi), le chef de l’État « jumeau » et voisin du sud, la cote de notoriété du général-major Juvénal Habyarimana, président du Rwanda, paraît nettement en retrait. Sans doute parce que son pouvoir, tel un long fleuve tranquille, s’attache à éviter les remous…
Des remous, le pays en a, certes, traversé depuis 1959. Il y a d’abord eu l’abolition de la monarchie, tutsi et tribaliste. Puis l’arrivée au pouvoir de la majorité hutu. Grégoire Kayibanda, président (civil) depuis l’indépendance de la tutelle belge, en 1962, jusqu’à son éviction le 5 juillet 1973, a été l’homme de la « révolution rwandaise », et de tous ses combats. En lui succédant en 1973, Habyarimana héritait d’une situation délicate : des centaines de milliers de Tutsi, la deuxième ethnie du pays (14 % de la population), avaient pris le chemin de l’exil, non sans avoir tenté, à plusieurs reprises, de reconquérir le pouvoir par la force. Le chef de I’ État rwandais, dans l’interview exclusive que nous publions ci-dessous, évoque largement ce sujet
Présidant aux destinées du peuple rwandais depuis plus de quinze ans, Juvénal Habyarimana, éduqué chez les Pères Barnabites de Bukavu (au Zaïre), est un homme simple et discret. Peu d’anecdotes filtrent de sa résidence, adjacente à un camp militaire proche de l’aéroport de Kigali-Kanombé, où il vit avec son épouse, Agathe Kanziga, et plusieurs de ses huit enfants. Quelles que puissent être les oppositions auxquelles il doit faire face, ce militaire de 52 ans (il est né le 8 mars 1937) est un président très populaire. On voit rarement des citoyens — étudiants, commerçants ou ecclésiastiques — se soucier autant de l’image de leur chef. A un journaliste français qui parlait de « culte de la personnalité » en voyant le portrait du général-major sur les pagnes de danseurs, un Rwandais musulman et anglophone (pour avoir vécu au Kenya) a rétorqué : « C’est que chez vous, vous ne savez plus vénérer le chef… »
Le président rwandais mène une vie sans histoire. C’est sans doute pourquoi il est encore si peu connu à l’étranger.
Les collaborateurs du général-major apprécient son calme et sa circonspection. « Avant de prendre une décision, confie un haut responsable du parti, surtout lorsqu’il s’agit d’une sanction, le président prend toujours le temps de demander plusieurs enquêtes et contre-enquêtes. » Une précaution élémentaire, mais qui n’a pas forcément cours partout en Afrique… De même, contrairement à un usage répandu sur le continent, les ministres n’apprennent pas leur nomination, ou leur révocation, à l’improviste, par la voix des ondes; ils sont consultés et informés au préalable. Relevés de leurs fonctions, ils ont droit à des éloges appuyés pour avoir « vaillamment et honorablement servi l’État ». En janvier, le président Habyarimana a demandé à ses compatriotes de l’« aider afin que ceux qui quittent leurs fonctions ne deviennent pas la risée de tous ».
Cette volonté de détente est propice au dialogue intérieur. Et au développement. Les Rwandais — près de six millions d’âmes — s’y sont attelés avec un sérieux qui pourrait rendre jaloux plus d’un dirigeant africain. Le problème crucial est celui de la surpopulation qui se traduit, pour ce peuple d’agriculteurs, par la surexploitation des terres et l’érosion.
Sillonnant le pays du nord au sud, de Gisenyi à Butaré, le visiteur est frappé par l’absence de terrains en friche. Tout, absolument tout, est mis en culture. Petits pois, bananes, riz, pommes de terre… Chaque paysan sait comment récupérer les terrains marécageux et réaliser des terrasses sur les versants. Ils grattent jusqu’au sommet des collines qui modèlent par milliers le paysage. Un fonctionnaire des Affaires étrangères m’a confié qu’il a gardé, d’un séjour d’études au Cameroun, une image inoubliable : celle de forêts se déroulant à perte de vue, de terres fertiles n’appartenant à personne. Un rêve qui doit hanter bien des Rwandais…
Le gouvernement de Kigali s’est donc engagé dans une politique d’émigration pour décongestionner les villages où la densité démographique atteint parfois 300 habitants au km2 ! La Tanzanie, notamment, pourrait accueillir des gens — si les autorités rwandaises prennent en charge toutes les infrastructures liées à leur installation, routes, écoles, hôpitaux… Des dépenses estimées à plusieurs milliards de F CFA. Rien n’est réglé.
Classé parmi les pays les moins avancés de la planète, le Rwanda accueille de nombreux organismes d’aide au développement qui, pour la plupart, y apprécient deux aspects : la facilité à suivre la réalisation des projets, en raison des dimensions réduites du pays, et l’homogénéité des orientations politiques. « Ailleurs, confie un volontaire allemand, vieux routier de la coopération, il nous est arrivé de recevoir des instructions contradictoires de trois instances différentes. A la fin, il nous fallait attendre parfois des mois pour savoir ce que les autorités souhaitaient réellement. » Pas étonnant qu’une équipe de télévision de Rhénanie-Palatinat, province allemande jumelée avec le Rwanda, ait décidé de réaliser un reportage sur cette « Suisse des Grands-Lacs » dans un but bien précis : « Nous pourrons ainsi montrer aux contribuables allemands que tout l’argent qu’ils versent pour l’aide au Tiers Monde ne sert pas seulement à alimenter les comptes en Suisse des dirigeants… » Au tableau d’honneur figure aussi la ponctualité du Rwanda dans le paiement de ses dettes et cotisations diverses (OUA, CEPGL, CEAC).
Cette rigueur n’est pas superflue pour les Rwandais qui commencent le travail à sept heures et se couchent tôt (au grand désespoir des amateurs de boîtes de nuit); nombreux sont les problèmes à résoudre pour dépasser un PNB par habitant de 290 dollars US. Le taux d’alphabétisation demeure faible, même si l’enseignement est dispensé essentiellement en kinyarwanda, la langue nationale, les élèves n’apprenant le français qu’à partir du secondaire. Il n’y a pas de quotidien national (le bulletin de l’Agence rwandaise de presse n’est destiné qu’aux fonctionnaires) et les mélomanes en sont pour leurs frais : la production de disques (ou de cassettes) des musiques locales n’a pas encore démarré. Pas plus que le cinéma : à ce jour, aucun réalisateur rwandais n’a produit une œuvre de fiction. Un moteur se met néanmoins en marche : dans deux ans, peut-être, la télévision…
M.R.B.
« La future convention sur la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux est le piller de l’intégration de la sous-région. »
J.A. : Comme les précédents, le dernier sommet annuel de la Communauté des pays des Grands Lacs (CEPGL), qui s’est tenu à Gisenyi, au Rwanda, s’est terminé sans que la Convention sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et sur le droit d’établissement ne soit ratifiée par vos deux partenaires, le Burundi et le Zaïre. N’êtes-vous pas déçu ?
J.H. : En allant à Gisenyi je l’étais effectivement, parce que, étant président en exercice de la CEPGL, j’avais cru que cette convention serait ratifiée pendant mon mandat. Comme nous avons pris du retard sur le délai d’entrée en vigueur fixé, c’est-à-dire janvier 1987, nous avons insisté à Bujumbura, en janvier 1988, sur la nécessité de la ratification. Vous avez entendu le langage qui a été tenu à Gisenyi et cette insistance sur la sécurité réciproque : j’ai constaté qu’il y avait un climat teinté presque de méfiance. Néanmoins, les chefs d’État ont pris des engagements solennels et publics. J’espère donc qu’au prochain sommet, cette convention sera ratifiée.
J.A. : De tous les instruments juridiques adoptés par la CEPGL, cette convention occupe une place de choix.
J.H. : C’est le pilier de l’intégration de notre sous-région. Mais toutes les mesures doivent être prises pour ménager les susceptibilités de part et d’autre.
J.A. : Concrètement, qu’est-ce qui freine le Zaïre et le Burundi ?
J.H. : J’ai envoyé des émissaires dans les deux pays. Du côté du Zaïre, on m’a fait savoir que la convention doit passer par plusieurs instances politiques, notamment le Comité central, le Parlement. Et le président Mobutu m’a assuré qu’au mois de mars, le processus serait terminé. En ce qui concerne le Burundi, le ministre des Affaires étrangères, Cyprien Mbonimpa, s’est, dans sa déclaration officielle à Gisenyi, référé aux événements de Ntega et de Marangara pour expliquer sa réticence. Le président Pierre Buyoya les a pareillement évoqués dans son allocation au banquet. Il y a donc une certaine suspicion. Selon la première version de ces événements, les instigateurs venaient de l’extérieur du Burundi, version que nous ne partageons pas du tout. Il est probablement vrai qu’il y a eu des tracts — dans quel pays n’y a-t-il pas de tracts ? — ou même des rumeurs provenant de l’extérieur. Mais croire que là réside la cause des événements est une erreur fondamentale. Le problème est interne et le président Buyoya en est conscient puis qu’il est maintenant engagé dans le processus de renforcement de l’unité nationale. Il a créé également une commission pour réfléchir à cette question. Donc toutes ces insinuations, à mon avis, doivent être prises en tant que telles. Néanmoins nous sommes convenus que nos services de sécurité se réuniraient périodiquement et rechercheraient très concrètement les moyens de renforcer la sécurité entre nos pays.
J.A. : Êtes-vous d’avis, comme d’autres dans votre pays, que le Rwanda, au sein de la CEPGL, donne beaucoup plus qu’il ne reçoit ?
J.H. : Je n’ai pas comparé les chiffres…
J.A. : En fait, il s’agit d’une impression globale…
J.H. : On m’a sorti une étude qui n’était pas très approfondie sur les infrastructures et les investissements réalisés dans les trois territoires. Mais depuis que nous avons fondé la CEPGL en 1976 et décidé de l’installer au Rwanda, nous n’avons plus rien obtenu, il est vrai.
La crise belgo-zaïroise ne gêne en rien nos relations avec Bruxelles. Ce qui nous gêne, c’est le conflit entre deux pays amis du Rwanda.
J.A : Un membre du trio de la CEPGL, le Zaïre, se trouve en conflit avec un pays étranger, la Belgique. Quelle est la position du Rwanda ?
J.H. : Nous n’avons pas à prendre position dans ce conflit. Bien entendu le président Mobutu nous a informés de l’évolution de l’affaire et nous lui avons donné notre avis. Mais c’est là un problème entre le Zaïre et la Belgique.
J.A : Le Rwanda pourrait-il formuler à l’égard de la Belgique les mêmes reproches que le Zaïre ? Votre pays a été, lui aussi, sous administration belge…
J.H. : Non, nous entretenons des relations fructueuses de coopération avec la Belgique. La détérioration des rapports entre la Belgique et le Zaïre ne gêne en rien nos relations avec la Belgique. Ce qui nous gêne, c’est que deux pays amis soient en conflit.
J.A : Le président Mobutu est pourtant venu s’assurer du soutien de ses partenaires de la CEPGL et il a rappelé le pacte qui vous unit : si l’un des membres de la CEPGL était victime de menées subversives, les autres réagiraient aussitôt. N’y avez-vous pas vu une allusion à la Belgique ?
J.H. : Non, parce que ce stade n’est pas atteint ! Je n’imagine pas que la Belgique va attaquer le Zaïre ni l’inverse ! J’ignore si c’est cela qui était sous-entendu, mais comme nous avons parlé de la sécurité intra-CEPGL, il était normal d’aborder ses prolongements extérieurs. Concernant le soutien à apporter au Zaïre, je pense que, dans les discussions qui se tiennent entre notre voisin et la Belgique, certaines vérités sont incontournables : en matière de coopération, quand un pays apporte son aide, cela lui est également profitable. Il n’y a pas lieu d’entrer en conflit, mais simplement de tirer les conclusions qui s’imposent pour renouer les liens sur de nouvelles bases.
J.A. : Quels sont les objectifs de la nouvelle commission spéciale pour les émigrés rwandais, créée en janvier ?
J.H. : Sa mission est d’étudier l’ensemble des questions qui se posent aux Rwandais vivant à l’extérieur — et cela ne concerne pas uniquement les réfugiés. Le cas de ces derniers est certes le plus poignant et le plus délicat. La commission aura donc à résoudre ces problèmes en concertation avec tous les intéressés : les pays voisins, qui hébergent les réfugiés et leur accordent, pour certains, la nationalité. Nous sommes prêts à les recevoir, avec ou sans nationalité étrangère, mais nous ne prétendons pas qu’ils viennent habiter ici. Notre position sur ce sujet est connue. Le Rwanda est un pays surpeuplé, il n’y a pas un seul centimètre carré de libre. Où voulez-vous qu’on mette de nouveaux arrivants alors que nous négocions avec les pays voisins pour permettre l’émigration de Rwandais vivant au Rwanda ? Ce serait contradictoire. Cette commission a donc été créée afin que les pays voisins et la communauté internationale comprennent notre position. Si nous nous trompons, ils nous le diront. Si nous avons raison, ils nous aideront à trouver des solutions. Cela dit, on m’a cité tel ou tel pays qui appelait ses réfugiés à rentrer. Mais les situations ne sont pas comparables d’un pays à l’autre. Certains, contrairement à nous, ne manquent pas de terres. Avant la colonisation, le Rwanda s’étendait au-delà des frontières actuelles. De plus, les choses se présentent différemment lorsqu’il s’agit de réfugiés récents. Imaginez quelqu’un qui est parti il y a trente ans : le terrain qu’il occupait seul regroupe désormais dix ou quinze familles. Entre-temps, lui-même a fondé une nombreuse famille. Vous voyez les complications.
J.A : Au fait, pourquoi sont-ils toujours considérés comme des réfugiés, même après trente ans de vie dans un pays étranger ?
J.H. : Je ne sais pas. Il y a évidemment le droit international au regard duquel un réfugié reste un réfugié. Mais tout de même, les lois sont faites pour les hommes et par les hommes. Après trente ans, les fils et petits-fils de réfugiés sont des nationaux ou, du moins, ils devraient l’être.
J.A. : Ces arguments ne semblent pas convaincre une partie de vos compatriotes expatriés. Le Rwanda est notre pays, disent-ils, et le droit d’y retourner est inaliénable…
J.H. : Je veux bien, mais si nous sommes cent dans une petite salle et que cinquante personnes de l’extérieur veulent y entrer, tout ce que nous pouvons leur dire c’est : vous en avez le droit, mais il n’y a pas de place !
« Il faut être fier de son origine, qu’elle soit hutu, tutsi ou twa. Mais ce qui importe, avant tout, c’est que chacun se considère comme un Rwandais à part entière. »
J.A. : Après les événements sanglants du Burundi, où la question ethnique a brutalement refait surface, on n’a pas manqué de tracer des parallèles avec le Rwanda et, notamment, d’évoquer la pratique des quotas, ou du dosage : 85 % des postes pour les Hutu, 14 % pour les Tutsi, et 1 % pour les Twa selon la proportion des uns et des autres dans la démographie rwandaise. Un tel système peut-il aussi engendrer des injustices même si son but est précisément de les corriger ?
J.H. : Écoutez, chaque pays a ses problèmes. Le Rwanda a les siens et je suppose que vous connaissez l’histoire de notre pays. Nous avions une monarchie s’appuyant sur une seule ethnie. Nous l’avons renversée en 1959. Pour éviter le retour à cette situation, nous avons décidé une politique d’équilibre. Il fallait partager, donc faire des calculs. Si vous êtes 14 %, vous aurez 14 % des places. Évidemment, s’agissant de rapports humains, les mathématiques ne sauraient être appliquées de manière rigide, il faut toutefois des principes de base.
On nous reproche de mentionner, sur la carte d’identité, l’ethnie hutu, tutsi, ou twa. Le simple fait de retirer l’indication « Hutu » de ma carte d’identité n’efface pas automatiquement mon appartenance à cette ethnie. Indiquer que tel est hutu ne le rend pas plus rwandais que les autres. Lorsqu’on indique sur votre passeport que vous êtes blond, que vous avez des yeux bleus et mesurez tant de centimètres, ce n’est pas une discrimination : c’est vrai. Dans les pays où l’appartenance ethnique n’est pas officialisée, comment sait-on, en cas d’incidents, qu’il y a tant de tués dans telle ou telle ethnie ? C’est parce qu’on les identifie de toute façon. Ailleurs, on n’ose pas le consigner, nous, nous le faisons. Et puis, c’est un vieux système; il existait déjà quand mon père est né.
J.A.: Étant donné le contexte sociohistorique, l’indication de l’ethnie n’est peut-être pas une démarche aussi neutre que la mention de la couleur des yeux ou des cheveux; on focalise l’attention sur un point délicat…
J.H. : Mais la carte d’identité ne comporte pas que l’ethnie ! Outre la description du titulaire est indiquée aussi sa région d’origine. Le fait d’inscrire sur la carte d’identité ce que vous êtes ne devrait pas vous gêner. Il faut être fier de son origine tutsi, hutu ou twa, et tout simplement se considérer comme un Rwandais à part entière. Voilà ce qu’il faut viser. S’il y avait des injustices, ce sont ces dernières qu’il faudrait combattre et non la question, secondaire, de l’indication de l’ethnie en tant que telle.
J.A. : Passons, si vous le voulez bien, à des questions plus personnelles. Beaucoup aimeraient en savoir davantage sur votre façon de vivre et de travailler. Par exemple, à quelle heure commence la journée du président du Rwanda ?
J.H. : Je me réveille à cinq heures avec Radio-Rwanda et je me mets au lit vers 21 heures. Entre les deux, comme vous vous en doutez, j’étudie des kilos de dossiers…
J.A. : Trouvez-vous le temps de lire ?
J.H. : Autre chose ? Très difficilement. Je lis la correspondance, les dossiers, des documents techniques sur une multitude de secteurs; on devient un peu polytechnicien, à la longue…
J.A. : Vous êtes un homme très croyant et chrétien comme près de 70 % des Rwandais.
J.H. : Je suis catholique comme l’étaient mes parents; j’ai été baptisé quand j’’avais huit jours et vais régulièrement à la messe avec ma famille.
J.A.: Comment organisez-vous vos loisirs ?
J.H. : Je prends très rarement des vacances. Parfois, lorsque j’ai besoin de repos, je me ménage une semaine de congé que je passe à l’intérieur du pays. Mais le téléphone ne me laisse pas beaucoup de répit. Deux fois, je me suis amusé à passer des vacances en Grèce, en souvenir de la Grèce antique rencontrée au temps de mes études. J’y suis resté chaque fois deux semaines : les Rwandais n’étaient pas contents.
J.A.: Les Rwandais portent votre effigie sur la poitrine : quelle en est la signification ?
J.H. : C’est l’insigne de notre parti, le MRND (Mouvement révolutionnaire national pour le développement). L’idée n’est pas de moi et on aurait peut-être pu trouver autre chose. Je sais que porter l’effigie d’un chef peut ressembler au culte de la personnalité. Je ne pense pas que ce soit le cas. En tout cas, j’y veille…
J.A : Le Rwanda, fait assez rare, est la vedette indirecte d’un film à succès sur la vie de la célèbre amie des gorilles, Dian Fossey, établie au nord du pays, près de Ruhengeri. Que savent les autorités rwandaises sur les circonstances de sa mort ?
J.H. : Concernant le film, j’en ai entendu le plus grand bien. Ma fille, qui fait ses études en France, m’a téléphoné pour me dire son enthousiasme. Nous en attendons des retombées touristiques considérables.
Cela dit, nous sommes étonnés d’entendre que Dian Fossey aurait été assassinée par des braconniers dans des circonstances non élucidées. La justice rwandaise sait pourtant que Dian Fossey a été tuée par un autre chercheur américain, dont le nom est connu. La police rwandaise a retrouvé dans les mains de Dian Fossey des cheveux blonds qui ont été envoyés à Paris pour être examinés. Les résultats étaient formels : ils étaient bien ceux du suspect en question qui avait déjà quitté le pays.
J.A. : Dian Fossey morte, le souci de protéger les gorilles, espèce en voie de disparition, demeure-t-il prioritaire ?
J.H. : Absolument. Nous avons installé une station d’études avec d’autres chercheurs, dont un Américain, un Belge et plusieurs Rwandais. Il est important que des citoyens rwandais assurent la relève. La protection de leur environnement les concerne plus que quiconque. •
JEUNE AFRIQUE NO 1474 – 5 AVRIL 1989